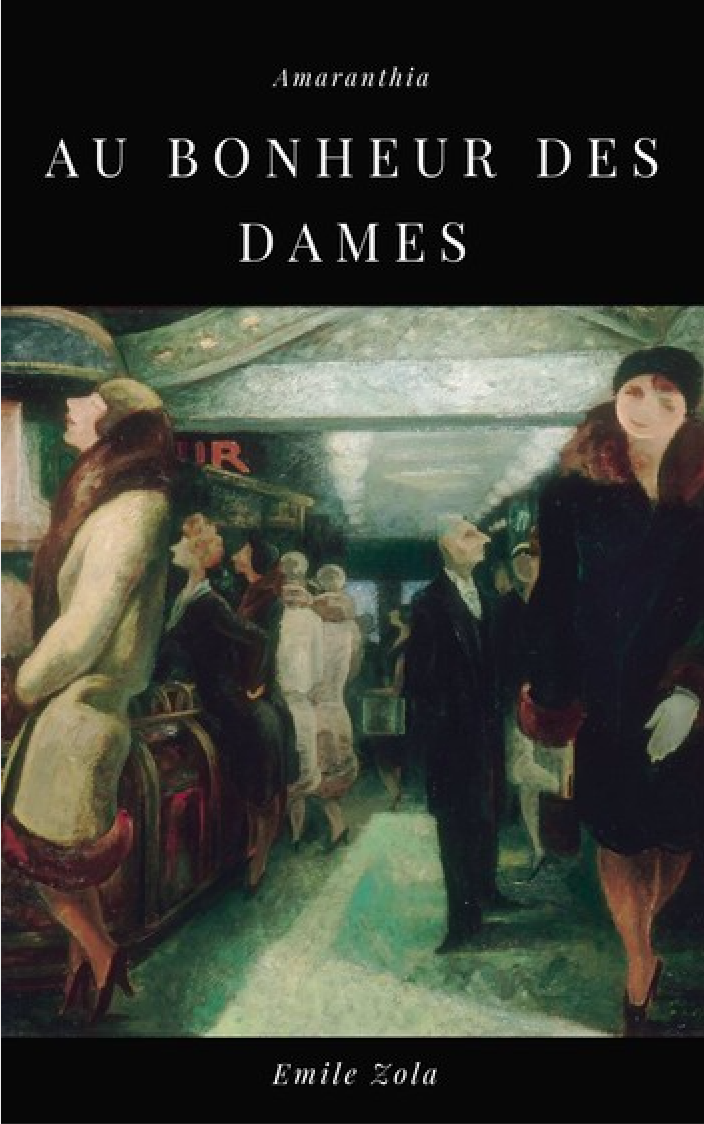La femme « qui les vengera toutes » : Denise et sa (douce) conquête du 𝐵𝑜𝑛ℎ𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑚𝑒𝑠
Marie Leduc
« Elle apportait tout ce qu’on trouve de bon chez la femme, le courage, la gaieté, la simplicité ; et, de sa douceur, montait un charme, d’une subtilité pénétrante de parfum » : figure d’une féminité qualifiée de « douce », la protagoniste Denise se démarque dans le monde égoïste décrit (et critiqué) par Zola dans Bonheur des dames. En tant que jeune femme vertueuse, grande sœur et vendeuse, elle prodigue des soins sans demander un quelconque service en retour.
Synopsis
Fraîchement arrivée à Paris avec ses deux frères dans l’espoir de travailler chez son oncle, Denise Baudu constate la ruine des petits commerces, ce qui la pousse à trouver un emploi dans un grand magasin, le Bonheur des Dames1. Dès lors, elle découvre la « machine capitaliste » stimulée par le gain, provoquant la misère de la jeune vendeuse et la précarité d’emploi. Peu à peu, Denise attire l’attention du directeur du magasin, Octave Mouret, qui souhaite faire de la jeune femme sa maîtresse. Fière, douce et chaste, elle refuse ses avances. En refusant de céder aux demandes de Mouret, Denise gagne de plus en plus d’influence au sein du magasin, de même que l’affection du directeur qui, fou d’amour, va jusqu’à la demander en mariage.
Figures du care : représentation et interactions
Les deux figures du care représentées sont celles de la vendeuse et de la « grande » sœur. Elles coexistent toutes deux au sein du personnage de Denise Baudu, figure centrale du roman.
La grande sœur : une « petite mère » dévouée
Denise est une jeune femme de vingt ans dont les parents sont décédés. Depuis leur mort, elle prend soin de ses deux frères, Pépé et Jean. En tant que sœur aînée, elle joue un rôle maternel : « Après la mort de leur père, qui avait mangé jusqu’au dernier sou dans sa teinturerie, elle était restée la mère des deux enfants » (ABD, 17). Ce rôle est d’ailleurs reconnu par ses jeunes frères, puisque Pépé appelle sa sœur « petite mère » (ABD, 431).
Après avoir travaillé comme vendeuse au magasin Cornaille à Valognes, Denise débarque à Paris avec ses frères, puisque « [ce] qu’elle gagnait chez Cornaille ne suffisait point à les nourrir tous les trois » (ABD, 17) et parce que Jean a obtenu une place chez un ivoirier parisien. Elle souhaite rester proche de son frère, qui a tendance à se jeter à corps perdu dans de dangereuses « escapade[s] amoureuse[s] » : « elle accompagnait surtout son frère à Paris pour veiller sur lui, prise de terreurs maternelles, devant ce grand enfant si beau et si gai, que toutes les femmes adoraient. » (ABD, 18) Toujours, Denise veille sur ses frères et s’inquiète pour « eux [,] qui n’avaient jamais quitté ses jupes » (ABD, p. 195).
Les frères de Denise sont ceux qui bénéficient le plus de ses soins. Le plus jeune, Pépé, est âgé de cinq ans au début du roman. Il est représenté comme un enfant doux, calme, demandant de l’affection : « L’enfant, câlin comme un petit chat, cachait sa tête, sans prononcer une parole. Quand Mme Baudu et Geneviève revinrent, elles le trouvèrent bien sage, et Denise assura qu’il ne faisait jamais plus de bruit : il restait muet des journées entières, vivant de caresses. » (ABD, 25) Au cours du roman, le comportement de Pépé ne cause aucun problème à Denise. Pépé, étant sage, est apprécié des adultes, qui aiment bien s’occuper de lui. À la fin du roman, il est âgé de douze ans. Outre son apparence, il n’a pas beaucoup changé : « Pépé, à douze ans, la dépassait déjà, plus gros qu’elle, toujours muet et vivant de caresses, d’une douceur câline dans sa tunique de collégien. » (ABD, 845)
Jean, quant à lui, a seize ans au début du roman. Jean est décrit comme doté d’une grande beauté : « Il avait la beauté d’une fille, une beauté qu’il semblait avoir volée à sa sœur, la peau éclatante, les cheveux roux et frisés, les lèvres et les yeux mouillés de tendresse. » (ABD,13). La beauté de Jean est particulièrement soulignée puisqu’elle séduit les femmes et qu’elle fait en sorte que « [t]oujours, il retomb[e] dans des histoires de femme » (ABD, 261).
Pour subvenir aux besoins de ses frères, Denise travaille d’arrache-pied et souffre de nombreuses privations :
Depuis son entrée au Bonheur des dames, l’argent était son cruel souci. Elle restait toujours au pair, sans appointements fixes ; et, comme ces demoiselles du rayon l’empêchaient de vendre, elle arrivait tout juste à payer la pension de Pépé, grâce aux clientes sans conséquence qu’on lui abandonnait. C’était pour elle une misère noire, la misère en robe de soie.
Souvent elle devait passer la nuit, elle entretenait son mince trousseau, reprisant son linge, raccommodant ses chemises comme de la dentelle ; sans compter qu’elle avait posé des pièces à ses souliers, aussi adroitement qu’un cordonnier aurait pu le faire. Elle risquait des lessives dans sa cuvette. Mais sa vieille robe de laine l’inquiétait surtout ; elle n’en avait pas d’autres, elle était forcée de la remettre chaque soir, quand elle quittait la soie d’uniforme, ce qui l’usait terriblement ; une tache lui donnait la fièvre, le moindre accroc devenait une catastrophe. Et rien à elle, pas un sou, pas de quoi acheter les menus objets dont une femme a besoin ; elle avait dû attendre quinze jours pour renouveler sa provision de fil et d’aiguilles. Aussi étaient-ce des désastres, lorsque Jean, avec ses histoires d’amour, tombait tout d’un coup et saccageait le budget. Une pièce de vingt sous emportée creusait un gouffre. (ABD, p. 262-263)
Denise souffre du manque d’argent et de sa « misère noire », « passe les nuits », mais ne garde « rien à elle, pas un sou ». Bien que Jean ne devrait pas lui causer trop de soucis puisqu’il est plus vieux et qu’il a une place chez un ivoirier qui le loge et le nourrit, il s’avère que ses aventures amoureuses sont ce qui cause une grande partie des problèmes de Denise :
Jean continuait à n’être pas raisonnable, il la harcelait toujours de demandes d’argent. Peu de semaines se passaient, sans qu’elle reçût de lui toute une histoire, en quatre pages ; et, quand le vaguemestre de la maison lui remettait ces lettres d’une grosse écriture passionnée, elle se hâtait de les cacher dans sa poche, car les vendeuses affectaient de rire, en chantonnant des gaillardises. Puis, après avoir inventé des prétextes pour aller déchiffrer les lettres à l’autre bout du magasin, elle était prise de terreurs : ce pauvre Jean lui semblait perdu. Toutes les bourdes réussissaient auprès d’elle, des aventures d’amour extraordinaires, dont son ignorance de ces choses exagérait encore les périls. (ABD, p. 329)
Jean n’apprend jamais de ses erreurs et a toujours besoin de plus d’argent pour payer des personnes le menaçant de révéler ses amours aux maris ou aux pères des femmes séduites. S’inquiétant pour son frère, Denise se prive de sommeil pour lui fournir l’argent.
La nuit, de neuf heures à une heure, elle pouvait en coudre six douzaines, ce qui lui faisait trente sous, sur lesquels il fallait déduire une bougie de quatre sous. Mais ces vingt-six sous par jour entretenaient Jean, elle ne se plaignait pas du manque de sommeil, elle se serait estimée très heureuse, si une catastrophe n’avait une fois encore bouleversé son budget. (ABD, 330)
Même si elle tente d’accumuler assez d’argent, Jean a toujours besoin de sommes plus considérables. Il arrive sur le lieu de travail de Denise, alors qu’elle le lui a pourtant interdit, pour lui redemander de l’argent. À ce moment, Denise « se fâch[e], torturée, poussée à bout » (ABD, 369) :
Je ne veux pas savoir. Garde pour toi ta mauvaise conduite. C’est trop vilain, entends-tu !... Et tu me tourmentes chaque semaine, je me tue à t’entretenir de pièces de cent sous. Oui, je passe les nuits... Sans compter que tu enlèves le pain de la bouche de ton frère.
Jean restait béant, la face pâle. Comment ! c’était vilain ? et il ne comprenait pas, il avait depuis l’enfance traité sa sœur en camarade, il lui semblait bien naturel de vider son cœur. Mais ce qui l’étranglait surtout, c’était d’apprendre qu’elle passait les nuits. L’idée qu’il la tuait et qu’il mangeait la part de Pépé, le bouleversa tellement, qu’il se mit à pleurer. (ABD, p. 369-370)
Denise, en tant que « mère » se sacrifiant volontairement pour ses « enfants », ne dit jamais à Jean tout ce qu’elle fait pour lui. Elle lui cache toujours les problèmes financiers auxquels elle est confrontée. C’est bien parce qu’elle est « poussée à bout » qu’elle lui en fait finalement part. Jean a toujours dépendu de Denise ; « il lui sembl[e] naturel de vider son cœur », de considérer la sollicitude de Denise comme acquise. Les soins de Denise, parce qu’ils lui sont « naturels », lui apparaissent garantis, et n’ont pas à être retournés :
Lorsqu’elle le sort de ses mauvaises postures, Jean ressent tout de même de la gratitude envers sa sœur : « – Cent sous ! criait chaque fois Jean. Sacristi ! tu es trop gentille !... Justement, il y a la femme du papetier...
– Tais-toi, interrompait Denise. Je n’ai pas besoin de savoir. » (ABD, p. 419).
Cette gratitude ne l’empêche toutefois guère de récidiver et de mettre Denise dans des situations financièrement difficiles.
Lorsqu’elle est renvoyée du Bonheur des dames, Denise fait face à une grande misère. Malgré tout, elle continue de prodiguer des soins à ses frères et tente de leur cacher son malheur. Elle donne et fait passer toujours leurs besoins avant les siens :
Alors, elle tâcha de se procurer de petits travaux ; seulement, dans son ignorance de Paris,
elle ne savait où frapper, acceptait des besognes ingrates, ne touchait même pas toujours son argent. Certains soirs, elle faisait dîner Pépé tout seul, d’une soupe, en lui disant qu’elle avait mangé dehors ; et elle se mettait au lit, la tête bourdonnante, nourrie par la fièvre qui lui brûlait les mains. Lorsque Jean tombait au milieu de cette pauvreté, il se traitait de scélérat, avec une telle violence de désespoir, qu’elle était obligée de mentir ; souvent, elle trouvait encore le moyen de lui glisser une pièce de quarante sous, pour lui prouver qu’elle avait des économies. Jamais elle ne pleurait devant ses enfants. Les dimanches où elle pouvait faire cuire un morceau de veau dans la cheminée, à genoux sur le carreau, l’étroite pièce retentissait d’une gaieté de gamins, insoucieux de l’existence. Puis, Jean retourné chez son patron, Pépé endormi, elle passait une nuit affreuse, dans l’angoisse du lendemain. (ABD, p. 386-387)
Puisqu’elle n’a plus les moyen de payer la pension de Pépé, Denise le reprend avec elle. Elle tente de lui offrir le nécessaire, de lui donner à manger, même si elle ne peut se procurer quoi que ce soit pour elle. Les soins de Denise pour ses frères sont inconditionnels et priment sur tout. Encore très jeune, Pépé ne voit pas à travers les mensonges de sa sœur. Le bien-être de « ses enfants » force Denise à maintenir devant eux l’illusion que tout va bien. Or, une fois qu’ils ne peuvent plus la voir, elle souffre en silence.
La « maternité » de Denise, une jeune fille irréprochable, rappelle l’idéal féminin chrétien de la Vierge Marie, figure de pureté et d’abnégation. S’il est, à priori, impossible d’être à la fois vierge et mère, Denise en tant que « grande sœur » et « petite mère » parvient à être à la fois une mère pour ses frères et chaste, intouchée. La narration met en relief l’abnégation et les soins que procure Denise à ses frères, sans demander quoi que ce soit en retour.
La vendeuse vierge : la femme qui les vengera toutes
Puisque son oncle, dans une situation financière de plus en plus précaire, ne peut l’engager comme vendeuse ou la loger, Denise se sépare à contrecœur du jeune Pépé et le place en pension, chez Madame Gras, une femme qui s’occupe bien de lui. Elle se trouve ensuite un emploi au grand magasin Au Bonheur des dames, qui cause progressivement la ruine de tous les petits commerçants du quartier. Les soins de Denise auprès de ses frères deviennent alors indirects : elle travaille d’arrache-pied afin de gagner l’argent nécessaire pour assurer leur bien-être, sans pourtant les côtoyer autant.
C’est en interagissant avec l’autre personnage principal du récit, Octave Mouret, propriétaire du grand magasin, que Denise obtient un poste. Il encourage la première du rayon des confections, Madame Aurélie Lhomme, à engager Denise comme vendeuse lorsqu’il apprend qu’elle est la nièce de Baudu, le drapier propriétaire du Vieil Elbeuf, situé en face du Bonheur des dames. Octave Mouret est « touché » (ABD, 11) par Denise, et « il [sent] chez cette jeune fille un charme caché, une force de grâce et de tendresse, ignorée d’elle-même » (ABD, 117), bien que son second, Bourdoncle, la considère « trop laide » (ABD, 115). Mouret, quant à lui, trouve Denise « jolie » (ABD, 118) lorsqu’elle rit.
Une fois engagée Au Bonheur des dames, Denise interagit avec plusieurs autres commerçant·e·s et vendeur·euse·s. Au début du roman, ses origines campagnardes, son manque d’argent et sa naïve jeunesse font en sorte qu’elle est le sujet de nombreuses moqueries de la part de ses collègues et de ses supérieurs du magasin.
Ensuite, son tourment fut d’avoir le rayon contre elle. Au martyre physique s’ajoutait la sourde persécution de ses camarades. Après deux mois de patience et de douceur, elle ne les avait pas encore désarmées. C’étaient des mots blessants, des inventions cruelles, une mise à l’écart qui la frappait au cœur, dans son besoin de tendresse. On l’avait longtemps plaisantée sur son début fâcheux ; les mots de « sabot », de « tête de pioche » circulaient, celles qui manquaient une vente étaient envoyées à Valognes, elle passait enfin pour la bête du comptoir. (ABD, 257)
La compétition entre vendeuses étant féroce, Denise n’est pas bien traitée par ses collègues du rayon des confections, qui l’insultent et colportent des ragots à son sujet. Deux vendeuses de son rayon, Marguerite Vadon et Clara Prunaire, lui rendent particulièrement la vie difficile : « Marguerite et Clara la poursuivaient d’une haine instinctive, serraient les rangs pour ne pas être mangées par cette nouvelle venue, qu’elles redoutaient sous leur affectation de dédain. » (ABD, 258) Clara prend d’ailleurs plaisir à appeler Denise « la mal peignée » (ABD, 160). Denise, toutefois, ne répond jamais à leurs insultes. Contrairement aux autres vendeuses de son rayon, elle ne tente pas de médire ses collègues ou de flatter la première du rayon, Mme Aurélie, afin d’obtenir une meilleure position dans le magasin. Elle travaille toutefois avec ardeur : elle se dévoue au travail, alors que Clara est « paresseuse à la vente » (ABD, 194). Si Clara a de multiples amants qui l’entretiennent et ne pense qu’à elle-même, Denise est chaste et doit travailler pour obtenir l’argent nécessaire pour s’occuper de ses frères.
Rejetée par ses collègues du rayon des confections, Denise développe une amitié avec Pauline Cugnot, qui vit elle aussi dans les espaces réservés aux travailleuses du magasin. Cependant, elles se côtoient peu pendant leurs heures de travail puisque Pauline est vendeuse au rayon des lingeries, qui est « en guerre ouverte » (ABD, 267) avec le rayon des confections. Pauline est elle aussi d’origine campagnarde. Âgée de vingt-six ans au début du roman, elle se reconnaît en Denise et devient sa confidente. Après avoir appris les difficultés financières auxquelles fait face la protagoniste, Pauline lui prête de l’argent à quelques reprises. Elle tente aussi de conseiller la jeune femme pour qu’elle s’adapte à la réalité parisienne ; à sa façon, Pauline prend soin de Denise, par amitié. Alors que celle-ci refuse les avances des hommes, Pauline lui recommande de prendre un amant. Lorsque Mouret témoigne de son intérêt pour Denise, Pauline l’encourage fortement à céder à ses avances.
Si les vendeuses prennent toutes des amants et ont cédé aux avances de Mouret, Denise tient tête, avec son « obstination de vierge » (ABD, 733), alors même qu’elle tombe amoureuse de lui. Denise ne refuse pas que les avances de Mouret ; Deloche, vendeur de dentelles venant d’une région voisine à celle de la protagoniste, est lui aussi amoureux de Denise. Le considérant comme un ami, elle ne cède jamais à ses demandes répétées.
Il semble que la chasteté de Denise est un élément lui permettant de se démarquer des autres vendeuses, qui sont plutôt liées, elles, à la figure de la prostituée. Cette association est sous-entendue notamment par les paroles des clientes plus riches du Bonheur ; Henriette Desforges, jalouse, allant jusqu’à dire que les vendeuses sont « toutes des malheureuses à vendre, comme leurs marchandises ! » (ABD, p. 652). Denise, quant à elle, a des standards moraux « supérieurs » à ceux des autres vendeuses : elle ne se donne guère, elle travaille pour obtenir son argent, elle prend soin de ses « enfants » et elle reste humble, dans un climat qui invite pourtant à la débauche à la fois des employés et des clientes.
Les dures semaines de travail étant particulièrement épuisantes, les vendeurs et les vendeuses profitent de leurs dimanches ou de leurs soirées pour se changer les idées en sortant, en prenant des amant.e.s, en buvant de l’alcool. Denise passe ses nuits à travailler davantage et à coudre, plutôt qu’à dépenser son argent durement gagné, puisqu’elle a « ses enfants » à sa charge. Constamment, le Bonheur des dames encourage l’excès : les profits atteignent des sommes faramineuses, et le magasin ne cesse de s’agrandir, de développer de nouveaux rayons, d’engager plus de vendeurs, d’exploiter plus de travailleurs. Tout le succès de Mouret réside dans son idée de génie : faire du Bonheur des dames une « mécanique à manger les femmes » (ABD, 163), ses clientes :
Alors, plus haut que les faits déjà donnés, au sommet, apparut l’exploitation de la femme. Tout y aboutissait, le capital sans cesse renouvelé, le système de l’entassement des marchandises, le bon marché qui attire, la marque en chiffres connus qui tranquillise. C’était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu’ils prenaient au continuel piège de leurs occasions, après l’avoir étourdie devant leurs étalages. Ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs, ils étaient une tentation immense, où elle succombait fatalement, cédant d’abord à des achats de bonne ménagère, puis gagnée par la coquetterie, puis dévorée. En décuplant la vente, en démocratisant le luxe, ils devenaient un terrible agent de dépense, ravageaient les ménages, travaillaient au coup de folie de la mode, toujours plus chère. Et si, chez eux, la femme était reine, adulée et flattée dans ses faiblesses, entourée de prévenances, elle y régnait en reine amoureuse, dont les sujets trafiquent, et qui paye d’une goutte de son sang chacun de ses caprices. Sous la grâce même de sa galanterie, Mouret laissait ainsi passer la brutalité d’un juif vendant de la femme à la livre : il lui élevait un temple, la faisait encenser par une légion de commis, créait le rite d’un culte nouveau, il ne pensait qu’à elle, cherchait sans relâche à imaginer des séductions plus grandes ; et, derrière elle, quand il lui avait vidé la poche et détraqué les nerfs, il était plein du secret mépris de l’homme auquel une maîtresse vient de faire la bêtise de se donner.
– Ayez donc les femmes, dit-il tout bas au baron, en riant d’un rire hardi, vous vendrez le monde !
Maintenant, le baron comprenait. Quelques phrases avaient suffi, il devinait le reste, et une exploitation si galante l’échauffait, remuait en lui son passé de viveur. Il clignait les yeux d’un air d’intelligence, il finissait par admirer l’inventeur de cette mécanique à manger les femmes. (ABD, 161-163)
Si les vendeuses sont comparées à des prostituées, les clientes du magasin sont, quant à elles, assimilées à des amantes, qui assouvissent le besoin de profit de Mouret : « Toutes lui appartenaient, étaient sa chose, et il n’était à aucune. Quand il aurait tiré d’elles sa fortune et son plaisir, il les jetterait en tas à la borne, pour ceux qui pourraient encore y trouver leur vie. » (ABD, 163) Maîtresses, objets, les clientes du Bonheur des dames « appartiennent » à Mouret, sont sa propriété. Il les utilise, puis s’en débarrasse. Elles « cèdent », se donnent à Mouret, qui les séduit avec ses étalages. Dès le début du roman, Bourdoncle avertit Mouret que son exploitation des femmes ne pourra pas durer : « Elles se vengeront… Il y en aura une qui vengera les autres, c’est fatal » (ABD, 71).
Denise est cette femme qui vengera les autres, sans qu’elle ne le sache : en refusant de céder à Mouret, elle le rend fou de désir :
Vingt fois, il l’avait suppliée, augmentant ses offres, offrant de l’argent, beaucoup d’argent. Puis, il s’était dit qu’elle devait être ambitieuse, il lui avait promis de la nommer première, dès qu’un rayon serait vacant. Et elle refusait, elle refusait encore ! C’était pour lui une stupeur, une lutte où son désir s’enrageait. Le cas lui semblait impossible, cette enfant finirait par céder, car il avait toujours regardé la sagesse d’une femme comme une chose relative. Il ne voyait plus d’autre but, tout disparaissait dans ce besoin : la tenir enfin chez lui, l’asseoir sur ses genoux, en la baisant aux lèvres ; et, à cette vision, le sang de ses veines battait, il demeurait tremblant, bouleversé de son impuissance. (ABD, 695-696)
En ne se donnant pas à Mouret, Denise gagne de l’influence sur lui. De plus en plus, elle est admirée des autres employés du Bonheur des dames :
Alors, un nouveau mouvement d’opinion se fit en faveur de Denise. Comme Bourdoncle, vaincu, répétait avec désespoir à ses familiers qu’il aurait donné beaucoup pour la coucher lui-même dans le lit de Mouret, il fut acquis qu’elle n’avait pas cédé, que sa toute-puissance résultait de ses refus. Et, dès ce moment, elle devint populaire. On n’ignorait pas les douceurs qu’on lui devait, on l’admirait pour la force de sa volonté. En voilà une, au moins, qui mettait le pied sur la gorge du patron, et qui les vengeait tous, et qui savait tirer de lui autre chose que des promesses ! Elle était donc venue, celle qui faisait respecter un peu les pauvres diables ! (ABD, p.744-745)
Denise devient une figure vengeresse pour les employés trop longtemps mal traités ; elle « met le pied sur la gorge du patron », est en position de pouvoir et le tient à sa merci. Mouret ne possède plus toutes les femmes : dorénavant, l’une d’entre elles lui résiste, le possède, et le guide.
Une position ambiguë : entre Le care et le capitalisme sauvage
Le care semble être ce qui, dans l’œuvre, permet à Denise de se distinguer dans le monde des grands magasins. Denise est du côté des « grands magasins, dans la bataille livrée entre ceux-ci et le petit commerce » (ABD, 428), mais elle reconnaît leurs défauts et leur inhumanité :
Denise, cette nuit-là, eut encore une insomnie. Elle venait de toucher le fond de son impuissance. Même en faveur des siens, elle ne trouvait pas un soulagement. Jusqu’au bout, il lui fallut assister à l’œuvre invincible de la vie, qui veut la mort pour continuelle semence. Elle ne se débattait plus, elle acceptait cette loi de la lutte ; mais son âme de femme s’emplissait d’une bonté en pleurs, d’une tendresse fraternelle, à l’idée de l’humanité souffrante. Depuis des années, elle-même était prise entre les rouages de la machine. N’y avait-elle pas saigné ? ne l’avait-on pas meurtrie, chassée, traînée dans l’injure ? Aujourd’hui encore, elle s’épouvantait parfois, lorsqu’elle se sentait choisie par la logique des faits. Pourquoi elle, si chétive ? pourquoi sa petite main pesant tout d’un coup si lourd, au milieu de la besogne du monstre ? Et la force qui balayait tout, l’emportait à son tour, elle dont la venue devait être une revanche. Mouret avait inventé cette mécanique à écraser le monde, dont le fonctionnement brutal l’indignait ; il avait semé le quartier de ruines, dépouillé les uns, tué les autres ; et elle l’aimait quand même pour la grandeur de son œuvre, elle l’aimait davantage à chacun des excès de son pouvoir, malgré le flot de larmes qui la soulevait, devant la misère sacrée des vaincus.
Le grand magasin est une « mécanique à écraser le monde », une « machine » aux rouages insensibles, un « monstre » duquel Denise a été elle-même victime. Malgré tout, Denise voit en les grands magasins le futur de la société, et ce même si elle est déchirée devant « la misère sacrée des vaincus », desquels fait partie sa famille. Les Baudu souffrent profondément à cause du grand magasin, symbole la logique capitaliste :
Celle-ci [Mme Baudu] avait sans doute deviné le nouveau coup reçu par la jeune fille, car ses yeux navrés allèrent d’elle à Colomban, puis se reportèrent sur le Bonheur. C’était vrai, il leur volait tout : au père, la fortune ; à la mère, son enfant mourante ; à la fille, un mari attendu depuis dix ans. (ABD, 485-486)
Geneviève, la cousine de Denise, en paie d’ailleurs les frais en tant que première victime « totale » du nouveau système économique lancé par Mouret : « C’était une obsession, ce pauvre corps de jeune fille était promené autour du grand magasin, comme la première victime tombée sous les balles, en temps de révolution » (ABD, 771). Bien qu’elle soit sensible au malheur des vaincus, Denise croit en la « révolution » lancée par Mouret.
Le Bonheur des dames de Mouret est comparé à une machine exploitant la femme et où les employé·e·s sont mal traité·e·s. Denise, incarnation du care, apporte une humanité à la machine, car elle se soucie des autres. Elle use donc de son influence auprès de Mouret pour « améliorer le mécanisme » :
Dans sa tête raisonneuse et avisée de Normande, poussaient toutes sortes de projets, ces idées sur le nouveau commerce, qu’elle osait effleurer déjà chez Robineau, et dont elle avait exprimé quelques-unes, le beau soir de leur promenade aux Tuileries. Elle ne pouvait s’occuper d’une chose, voir fonctionner une besogne, sans être travaillée du besoin de mettre de l’ordre, d’améliorer le mécanisme. Ainsi, depuis son entrée au Bonheur des dames, elle était surtout blessée par le sort précaire des commis ; les renvois brusques la soulevaient, elle les trouvait maladroits et iniques, nuisibles à tous, autant à la maison qu’au personnel. Ses souffrances du début la poignaient encore, une pitié lui remuait le cœur, à chaque nouvelle venue qu’elle rencontrait dans les rayons, les pieds meurtris, les yeux gros de larmes, traînant sa misère sous sa robe de soie, au milieu de la persécution aigrie des anciennes. Cette vie de chien battu rendait mauvaises les meilleures ; et le triste défilé commençait : toutes mangées par le métier avant quarante ans, disparaissant, tombant à l’inconnu, beaucoup mortes à la peine, phtisiques ou anémiques, de fatigue et de mauvais air, quelques-unes roulées au trottoir, les plus heureuses mariées, enterrées au fond d’une petite boutique de province. Était-ce humain, était-ce juste, cette consommation effroyable de chair que les grands magasins faisaient chaque année ? Et elle plaidait la cause des rouages de la machine, non par des raisons sentimentales, mais par des arguments tirés de l’intérêt même des patrons. Quand on veut une machine solide, on emploie du bon fer ; si le fer casse ou si on le casse, il y a un arrêt du travail, des frais répétés de mise en train, toute une déperdition de force. Parfois, elle s’animait, elle voyait l’immense bazar idéal, le phalanstère du négoce, où chacun aurait sa part exacte des bénéfices, selon ses mérites, avec la certitude du lendemain, assurée à l’aide d’un contrat. Mouret alors s’égayait, malgré sa fièvre. Il l’accusait de socialisme, l’embarrassait en lui montrant des difficultés d’exécution ; car elle parlait dans la simplicité de son âme, et elle s’en remettait bravement à l’avenir, lorsqu’elle s’apercevait d’un trou dangereux, au bout de sa pratique de cœur tendre. Cependant, il était ébranlé, séduit, par cette voix jeune, encore frémissante des maux endurés, si convaincue, lorsqu’elle indiquait des réformes qui devaient consolider la maison ; et il l’écoutait en la plaisantant, le sort des vendeurs était amélioré peu à peu, on remplaçait les renvois en masse par un système de congés accordés aux mortes-saisons, enfin on allait créer une caisse de secours mutuels, qui mettrait les employés à l’abri des chômages forcés, et leur assurerait une retraite. C’était l’embryon des vastes sociétés ouvrières du vingtième siècle. (ABD, p. 740-742)
Si les arguments axés sur le care ont peu d’effet auprès du propriétaire, Denise ne s’arrête guère. Elle parvient à le convaincre de la nécessité de l’amélioration des conditions de vie des employés en « plaid[ant] la cause des rouages de la machine, non par ? des raisons sentimentales, mais par des arguments tirés de l’intérêt même des patrons ». Elle utilise la métaphore du fer pour appuyer ses arguments. Le grand magasin Au Bonheur des dames devient alors une figure exemplaire du capitalisme sauvage, qui est lui aussi souvent comparé à une machine, et des « vastes sociétés ouvrières du vingtième siècle ».
À sa façon, avec ses « idées délicates de femmes » (ABD, 743), Denise s’immisce dans le monde « masculin » de l’argent, du bénéfice et du profit pour le transformer. Ses qualités féminines permettent d’adoucir la dureté du capitalisme, en fournissant davantage de soins aux employé·e·s du magasin :
D’ailleurs, Denise ne s’en tenait pas à vouloir panser les plaies vives dont elle avait saigné : des idées délicates de femme, soufflées à Mouret, ravirent la clientèle. Elle fit aussi la joie de Lhomme, en appuyant un projet qu’il nourrissait depuis longtemps, celui de créer un corps de musique, dont les exécutants seraient tous choisis dans le personnel. Trois mois plus tard, Lhomme avait cent vingt musiciens sous sa direction, le rêve de sa vie était réalisé. Et une grande fête fut donnée dans les magasins, un concert et un bal, pour présenter la musique du Bonheur à la clientèle, au monde entier. Les journaux s’en occupèrent, Bourdoncle lui-même, ravagé par ces innovations, dut s’incliner devant l’énorme réclame. Ensuite, on installa une salle de jeu pour les commis, deux billards, des tables de trictrac et d’échecs. Il y eut des cours le soir dans la maison, cours d’anglais et d’allemand, cours de grammaire, d’arithmétique, de géographie ; on alla jusqu’à des leçons d’équitation et d’escrime. Une bibliothèque fut créée, dix mille volumes mis à la disposition des employés. Et l’on ajouta encore un médecin à demeure donnant des consultations gratuites, des bains, des buffets, un salon de coiffure. Toute la vie était là, on avait tout sans sortir, l’étude, la table, le lit, le vêtement. Le Bonheur des dames se suffisait, plaisirs et besoins, au milieu du grand Paris, occupé de ce tintamarre, de cette cité du travail qui poussait si largement dans le fumier des vieilles rues, ouvertes enfin au plein soleil.
Alors, un nouveau mouvement d’opinion se fit en faveur de Denise. (ABD, p. 742-744)
La protagoniste participe activement à l’élévation des conditions de vie du milieu et se soucie des autres. Même si elle n’a pas elle-même souffert de certaines situations, elle tente de les corriger. Une fois de plus, Denise devient une « petite mère » prenant soin de tous les employés du magasin. Elle aide d’ailleurs son amie Pauline, à conserver son travail lorsque celle-ci sera enceinte, le Bonheur ne supportant pas les vendeuses enceintes :
Une des grandes joies de Denise, dans sa faveur, fut de pouvoir être utile à Pauline. Celle-ci était enceinte, et elle tremblait, car deux vendeuses, en quinze jours, avaient dû partir au septième mois de leur grossesse. La direction ne tolérait pas ces accidents-là, la maternité était supprimée comme encombrante et indécente, à la rigueur, on permettait le mariage, mais on défendait les enfants. Pauline, sans doute, avait un mari dans la maison ; elle se méfiait pourtant, elle n’en était pas moins impossible au comptoir ; et, afin de retarder un renvoi probable, elle se serrait à étouffer, résolue de cacher ça tant qu’elle pourrait. Une des deux vendeuses congédiées venait justement d’accoucher d’un enfant mort, pour s’être torturé ainsi la taille ; on désespérait de la sauver elle-même. Cependant, Bourdoncle regardait le teint de Pauline se plomber, tandis qu’il lui trouvait une raideur pénible dans la démarche. Un matin, il était près d’elle, aux trousseaux, quand un garçon de magasin, qui enlevait un paquet, la heurta d’un tel coup, qu’elle porta les deux mains à son ventre, en poussant un cri. Tout de suite, il l’emmena, la confessa, soumit au conseil la question de son renvoi, sous le prétexte qu’elle avait besoin du bon air de la campagne : l’histoire du coup allait se répandre, l’effet serait désastreux sur le public, si elle faisait une fausse couche, comme il y en avait eu déjà une aux layettes, l’année précédente. Mouret, qui n’assistait pas à ce conseil, ne put donner son avis que le soir. Mais Denise avait eu le temps d’intervenir, et il ferma la bouche de Bourdoncle, au nom des intérêts mêmes de la maison. On voulait donc ameuter les mères, froisser les jeunes accouchées de la clientèle ? Pompeusement, il fut décidé que toute vendeuse mariée, qui deviendrait enceinte, serait mise chez une sage-femme spéciale, dès que sa présence au comptoir blesserait les bonnes mœurs. (ABD, p.745-747)
Denise tire un véritable bonheur (« grandes joies ») à « être utile », à venir en aide. Elle contribue à améliorer la condition de toutes les femmes du magasin, en leur évitant un renvoi brutal lors de la grossesse. Denise parvient toujours à appuyer les idées en fournissant des « raisons logiques » servant l’image de la maison et, finalement, au profit. La femme enceinte est, grâce à l’aide de la protagoniste, mieux traitée, mais elle devient aussi un outil de marketing. En s’occupant de l’employée enceinte, le Bonheur des dames donne l’impression au grand public qu’il tient toutes les mères en haute estime, par extension. Dans la mesure où la majorité des clientes sont mères, cet acte de « sollicitude » est surtout une possibilité de gain pour Mouret, et en cela, ce qui pourrait être un mouvement de care devient surtout un acte purement capitaliste. Après tout, comme l’explique Adam Smith, « it is not from de benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities, but of their advantages2 ».
En tant que femme et ayant elle-même souffert de la précarité de la position de vendeuse, Denise comprend la clientèle et les employés, et c’est justement cette compréhension qui permet de reconstruire au Bonheur des dames une « image de marque » de laquelle elle tirera profit. Le care de Denise, sans être à ses propres yeux entièrement motivé par ce désir, permet tout de même de générer d’importants gains ; ce qui convainc finalement les hommes en position de force à mettre en place les changements qu’elle suggère.
Les soigné·e·s
Denise gagne l’estime et l’admiration des employé·e·s du Bonheur des dames en ne cédant pas aux demandes de Mouret et en apportant des changements positifs dans le quotidien des employés du Bonheur qui, bénéficiant des efforts de Denise, sont « fiers d’elle » (ABD, 744), « admira[tifs devant] la force de sa volonté » (ABD, 744). Ils ressentent une gratitude pour l’aide qu’elle leur apporte : « on n’ignorait pas les douceurs qu’on lui devait » (ABD, 744). soigné
Après son retour au magasin, Denise grimpe des échelons. Elle devient seconde des confections, puis première d’un nouveau rayon de confections pour les enfants créé par Mouret. Denise en est en charge, mais elle continue d’exercer le métier de vendeuse. Elle s’occupe alors de sa nouvelle clientèle, les enfants, et elle y excelle :
C’était surtout à son rayon qu’il fallait la voir, au milieu de son peuple de bambins de tout âge. Elle adorait les enfants, on ne pouvait la mieux placer. Parfois, on comptait là une cinquantaine de fillettes, autant de garçons, tout un pensionnat turbulent, lâché dans les désirs de la coquetterie naissante. Les mères perdaient la tête. Elle, conciliante, souriait, faisait aligner ce petit monde sur des chaises, et, quand il y avait dans le tas une gamine rose, dont le joli museau la tentait, elle voulait la servir elle-même, apportait la robe, l’essayait sur les épaules potelées, avec des précautions tendres de grande sœur. Des rires clairs sonnaient, de légers cris d’extase partaient, au milieu de voix grondeuses. Parfois, une fillette déjà grande personne, neuf ou dix ans, ayant aux épaules un paletot de drap, l’étudiait devant une glace, se tournait, la mine absorbée, les yeux luisant du besoin de plaire. Et le déballage encombrait les comptoirs, […] quelque chose comme le vestiaire d’une bande de grandes poupées, sorti des armoires et livré au pillage. Denise avait toujours au fond des poches quelques friandises, apaisait les pleurs d’un marmot désespéré de ne pas emporter des culottes rouges, vivait là parmi les petits, comme dans sa famille naturelle, rajeunie elle-même de cette innocence et de cette fraîcheur sans cesse renouvelées autour de ses jupes. (ABD, p. 738-740)
Denise a un talent pour s’occuper des enfants : elle l’a développé comme « petite mère » de ses frères. La « maternité » virginale de Denise et ses qualités de mère sont mise de l’avant dans la narration. Si les « vraies » mères sont dépassées et « perd[ent] » la tête », Denise est chez elle parmi « son peuple de bambins » sur lequel elle règne en étant « conciliante » et « souri[ante] », des qualités traditionnellement associées au féminin. La patience et les soins pour les enfants semblent venir facilement à Denise, sans qu’elle n’ait à faire de véritable effort.
Enfin, Denise prend également soin de sa cousine Geneviève, qui tombe malade lorsqu’elle devine que Colomban en aime une autre, et de sa tante après le décès de sa fille. Dès le début du roman zolien, les deux femmes sont représentées comme étant frêles et pâles :
En quelques phrases brèves, il mettait au courant Mme Baudu et sa fille. La première était une petite femme mangée d’anémie, toute blanche, les cheveux blancs, les yeux blancs, les lèvres blanches. Geneviève, chez qui s’aggravait encore la dégénérescence de sa mère, avait la débilité et la décoloration d’une plante grandie à l’ombre. Pourtant, des cheveux noirs magnifiques, épais et lourds, poussés comme par miracle dans cette chair pauvre, lui donnaient un charme triste. (ABD, p. 20)
Geneviève, promise à Colomban depuis l’enfance, l’aime « d’une passion profonde qu’elle ignorait d’elle-même » (ABD, 30), alors que « la certitude de l’avoir [empêche Colomban] de la désirer » (ABD, 30). Il est plutôt amoureux de Clara Prunaire, la collègue de Denise ayant de multiples amants.
La protagoniste découvre le malheur et la maladie de sa cousine et, pleine de sollicitude, tente de l’aider. Elle essaie de lui apporter un certain réconfort, sans succès : « Des mois se passèrent. Denise entrait presque tous les jours égayer un instant Geneviève. Mais la tristesse augmentait chez les Baudu. » (ABD, 455) Elle décide alors d’intervenir auprès de Colomban :
Mais elle le fit taire, elle l’attira dans un coin. Et, baissant la voix :
– C’est à vous que je veux parler... Vous manquez donc de cœur ? vous ne voyez donc pas que Geneviève vous aime et qu’elle en mourra ?
Elle était toute frémissante, sa fièvre de la veille la secouait de nouveau. Lui, effaré, étonné de cette brusque attaque, ne trouvait pas une parole.
– Entendez-vous ! continua-t-elle. Geneviève sait que vous en aimez une autre. Elle me l’a dit, elle a sangloté comme une malheureuse... Ah ! la pauvre enfant ! elle ne pèse plus lourd, allez ! Si vous aviez vu ses petits bras ! C’est à pleurer... Dites, vous ne pouvez pas la laisser mourir ainsi !
Il parla enfin, tout à fait bouleversé.
– Mais elle n’est pas malade, vous exagérez... Moi, je ne vois pas... Et puis, c’est son père qui recule le mariage.
Denise, rudement, releva ce mensonge. Elle avait senti que la moindre insistance du jeune homme déciderait l’oncle. Quant à la surprise de Colomban, elle n’était pas feinte : il ne s’était réellement jamais aperçu de la lente agonie de Geneviève. Ce fut, pour lui, une révélation très désagréable. Tant qu’il ignorait, il n’avait pas de reproches trop gros à se faire. (ABD, 479-480)
Comme le père de Geneviève, Colomban ne se rend pas compte du malheur de celle qui lui était promise. L’ignorance les « protège », les empêche de se reprocher leur comportement, les éloigne de la sollicitude. Les hommes semblent moins enclins à deviner le malheur des autres par eux-mêmes, tandis que les femmes du roman (Denise, Mme Baudu) parviennent à le déceler, grâce à une plus grande sensibilité, ce qui rejoue l’un des éternels clichés du féminin.
Il semble qu’il y a ait un lien entre gender et care ou, plus précisément, entre maternité et care. La mère de Geneviève est celle qui remarque la douleur de sa fille en premier (même si celle-ci essaie de la lui cacher) et elle tente de l’aider. Lorsque Geneviève tombe gravement malade, l’oncle Baudu se trouve toujours au chevet de sa fille. Toutefois, il n’avait guère remarqué son mal être avant que sa femme ne lui en fasse part.
Similairement, bien qu’il y ait beaucoup de vendeurs (hommes) et de vendeuses (femmes) au Bonheur des dames, seule Denise est véritablement associée au care : il semble que le care soit étroitement lié à sa disposition « maternelle » en tant que grande sœur qui prend soin de ses deux frères cadets. Toutefois, la maternité seule n’est pas gage de disposition au care. La précarité financière est, elle aussi, un facteur contribuant au care. Il semble que les gens issus des classes sociales moins élevées soient davantage disposés à prendre soin des autres. Bourras, craignant lui-même la ruine, aide Denise en lui offrant un emploi, et en s’occupant parfois de Pépé. Il existe, dans le Paris représenté, une forme de solidarité et d’entraide entre les petits commerçants en faillite.
Denise elle-même appartient à une classe sociale inférieure à celle de ses clientes. Issue de la petite bourgeoisie provinciale (son père avait un magasin à Valognes), elle devient toutefois très pauvre puisque son père, avant son décès, dépense tout son argent pour son commerce. Le care maternel de Denise est plus impressionnant, puisqu’elle seule doit s’occuper des deux jeunes enfants. Son abnégation et les soins qu’elle procure en se sacrifiant semblent amplifiés par la situation financière dans laquelle elle se trouve. Aucune autre femme riche du roman (même si elle est mère) n’est associée au care : elles ne sont jamais décrites en train de prodiguant des soins à leurs enfants. Elles ne sont en leur compagnie que lorsqu’elles les amènent magasiner…
Denise : le féminin « idéal(isé) »
L’héroïne se démarque de toutes les autres femmes, même de celles qui appartiennent à une classe sociale supérieure à la sienne. La voix narrative porte un discours admiratif sur Denise, faisant ressortir ses qualités, toutes associées à un « féminin » traditionnel chrétien :
Elle apportait tout ce qu’on trouve de bon chez la femme, le courage, la gaieté, la simplicité ; et, de sa douceur, montait un charme, d’une subtilité pénétrante de parfum. On pouvait ne pas la voir, la coudoyer ainsi que la première venue ; bientôt, le charme agissait avec une force lente, invincible ; on lui appartenait à jamais, si elle daignait sourire. Tout souriait alors dans son visage blanc, ses yeux de pervenche, ses joues et son menton troués de fossettes ; tandis que ses lourds cheveux blonds semblaient s’éclairer aussi, d’une beauté royale et conquérante. Il s’avouait vaincu, elle était intelligente comme elle était belle, son intelligence venait du meilleur de son être. Lorsque les autres vendeuses, chez lui, n’avaient qu’une éducation de frottement, le vernis qui s’écaille des filles déclassées, elle, sans élégances fausses, gardait sa grâce, la saveur de son origine. (ABD, p. 694-695)
Ce sont les qualités « féminines » et valorisées par la religion chrétienne de Denise qui sont toujours rappelées par la narration et qui la lient à « tout ce qu’on trouve de bon chez la femme ». Ainsi, Denise représente l’idéal de la féminité grâce à sa « sensibilité » (ABD, 255), sa « vaillance » (ABD, 257), son « courage » (ABD, 255), sa « simplicité » (ABD, 694) son « honnêteté » (ABD, 277), son « intelligence » (ABD, 694), sa « gentille[sse] » (ABD, 747), sa « gaité » (ABD, 325), sa « fierté » (ABD, 733), sa « modestie » (ABD, 756) et, surtout, sa « douceur invincible » (ABD, 256) et naturelle. Ce sont toutes ces qualités de Denise qui lui permettent de se distinguer parmi la masse des Parisiennes. La douceur de Denise est, très particulièrement, mise de l’avant, ce qui n’est guère surprenant : la douceur est une qualité souvent associée aux soigneuses.
Denise n’est pas d’une beauté provocatrice ou particulièrement séduisante. Son apparence jeune et sa beauté humble et discrète sont soulignées : « le sourire, sur sa bouche un peu grande, était comme un épanouissement du visage entier. Ses yeux gris prirent une flamme tendre, ses joues se creusèrent d’adorables fossettes, ses pâles cheveux eux-mêmes semblèrent voler, dans la gaieté bonne et courageuse de tout son être. » (ABD, p. 118) La narration souligne souvent la jeunesse de Denise, de telle sorte qu’elle est parfois même infantilisée : le narrateur la dit « chétive » (ABD, 115), « mince, pas plus grosse qu’une mauviette » (ABD, 845) et fait référence à ses « petits pieds de fillette » (ABD, 256). Cette jeunesse et l’infantilisation rappellent la virginité de Denise, mentionnée à sept reprises dans le roman. La virginité de la protagoniste participe étroitement à son héroïsme, comme l’explique Natalie Heinich :
il ne peut y a voir d’héroïne que vierge : l’élévation au statut héroïque exige pour une femme ce sacrifice de la sexualité, faisant de la virginité non une circonstance temporaire et temporelle mais un véritable statut, consubstantiel à la personne. Ainsi faut-il comprendre la qualification par leur virginité des deux grandes héroïnes de la chrétienté : la Vierge Marie et Jeanne la Pucelle.3
En étant à la fois mère, vierge et jeune, Denise représente un idéal religieux impossible à atteindre, héroïque. C’est peut-être ce qui explique, en partie, sa « toute-puissance » au Bonheur des dames et sa victoire parisienne à la fin du roman, alors que tant de personnages de Zola échouent à grimper les échelons sociaux.
Références bibliographiques
Corpus primaire
Zola, Emile, Au Bonheur des dames, Bibliothèque électronique du Québec, coll. « À tous les vents », vol. 65, [1882], 904 p., https://beq.ebooksgratuits.com/vents/zola-11.pdf.
Corpus critique
Castro, Carmen de, « La femme travailleuse (Au bonheur des dames) d’Émile Zola », Alfinge: Revista de filología, no 5, 1987, p. 13‑30.
Cnockaert, Véronique, « Denise ou la vertu attentatoire dans Au bonheur des dames », dans Anna Gural-Migdal (dir.), L’écriture du féminin chez Zola et dans la fiction naturaliste, Berne, Peter Lang, 2004, p. 437‑448.
Heinich, Nathalie, États de femme : l’identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard, 2018 [1996].
Jaouen, Françoise, « Le Bonheur des Dames ou la machine du célibataire », Qui Parle, vol. 2, no 1, 1988, p. 98‑112.
Lesselier, Claudie, « Employées de grands magasins à Paris (avant 1914) », Le Mouvement social, no 105, 1978, p. 109‑126.
Rachwalska von Rejchwald, Jolanta, « Femme, pouvoir, espace dans Au bonheur des dames et Une page d’amour d’Émile Zola », Tangence, no 94, 2010, p. 87‑111.
Roux, Suzanne, « La citadine et le monde du travail chez Zola : cas particulier des vendeuses dans Au bonheur des dames », Estudios Románicos, no 5, 1989, p. 1229‑1236.
Sikubwabo, Theodore, La causalité de la précarité et de la dévalorisation de la femme zolienne dans « Au Bonheur des Dames », « L’assomoir » et « Germinal », Mémoire de maîtrise, Nothern Illinois University, 2015, 59 p.
Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol. talibri [En ligne], 2007, 754 p., https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf.
Emile Zola, Au Bonheur des dames, Bibliothèque électronique du Québec, coll. « À tous les vents », vol. 65, [1882], 904 p., https://beq.ebooksgratuits.com/vents/zola-11.pdf. Afin d’alléger la lecture, nous utiliserons dorénavant le sigle « ABD » pour se référer au roman.↩︎
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Metalibri [En ligne], 2007, p. 16, https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf.↩︎
Nathalie Heinich, États de femme : l’identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, 2018 [1996], p. 30.↩︎